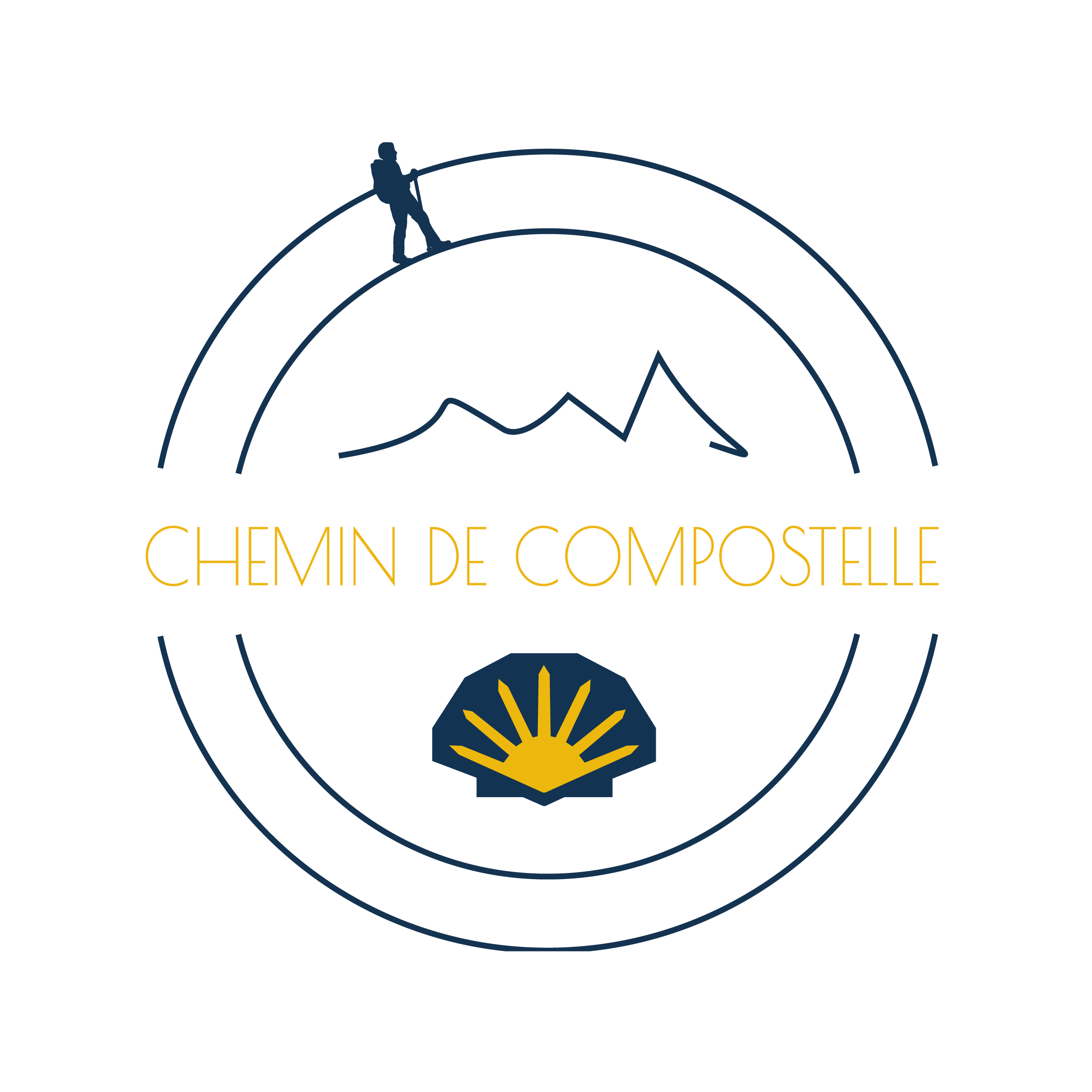Canal de Nantes à Brest : l’itinérance à pied ou à vélo
De la cité des Ducs jusqu’au nord de Finistère, parcourez sur le chemin de halage tout ou partie des 364 km où chaque escale vous fera découvrir les trésors d’ingéniosité imaginés pour qu’un bateau puisse naviguer entre Nantes et Brest : 239 écluses jalonnent le parcours !


Le canal de Nantes à Brest, c’est le chemin idéal pour un randonneur au long cours débutant. En effet, beaucoup de gens rêvent de partir randonner, à pied ou à bicyclette, plusieurs jours ou plusieurs semaines de suite, mais ne le font pas pour de multiples raisons. Sur ce parcours, beaucoup de verrous sautent. Tout d’abord, vous n’aurez pas vraiment besoin de cartes (il est facile de suivre la voie d’eau d’écluse en écluse, du cœur de Nantes au débouché dans la rade de Brest…). Pas (trop) de fatigue en vue non plus. Parcourir un chemin de halage est une première étape rassurante dans l’apprentissage de la randonnée au long court. En effet, la plupart des canaux sont construits à plat…, ce qui, chacun en conviendra, est plus pratique pour la circulation des péniches !
Le canal traverse les départements bretons d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, des Côtes-d’Armor et du Finistère ; en Loire-Atlantique (région Pays-de-la-Loire), il parcourt seulement 95 km entre Nantes et Saint-Nicolas-de-Redon en empruntant d’abord l’Erdre. Cette section comprend 18 écluses.
À pied, Il faut environ 2 semaines pour effectuer les 364 km de l’itinéraire. A vélo, il ne vous faudra que 6 à 7 jours. C’est à chacun de décider de la durée, en fonction de sa forme physique, de la météorologie, des nuitées… Pour cette raison, le guide donnera seulement la liste des services et commerces, les hébergements et le ravitaillement, ainsi que les distances, sans jamais parler d’étapes. Enfin, comme ce chemin est interdit à toute circulation motorisée, il est aussi particulièrement adapté à la randonnée… en famille !
De Nantes à Brest ou… de Brest à Nantes ?
L’itinéraire est décrit de Nantes vers Brest pour une raison très simple, c’est que le canal porte pour nom « de Nantes à Brest », qu’il y a bien une cause à cette appellation, et qu’il existe toujours une certaine mystique à cette course vers l’occident, le Finistère, la fin des terres… Mais rien n’interdit de le parcourir dans l’autre sens, sauf qu’on aura le soleil dans l’œil tous les matins…
Un itinéraire (largement) carrossable
Un chemin de halage bien entretenu est une piste idéale pour randonner en toute sécurité. Cette absence de danger permet de pédaler tranquillement, de profiter du paysage paisible, d’observer la vie du canal. Il est carrossable tout au long du trajet. Sa largeur est d’environ deux mètres, et il est presque partout revêtu de gravillons ou de terre. Même si certaines sections du canal ont été déclassées en tant que voie d’eau navigable, le canal et le chemin qui le borde sont toujours restés dans le domaine public. Ils sont régulièrement entretenus, et vous n’y rencontrerez ni fondrière, ni difficulté technique particulière.
Toutefois, le canal fait partie du réseau de voies vertes permettant d’aller d’un bout de l’Europe à l’autre, le goudronnage de la bande cyclable s’étend hélas chaque année de plus en plus loin. C’est peut-être bien pour les pneus des bicyclettes, mais beaucoup moins confortable pour les chaussures de marche.
C’est quoi, un chemin de halage ?
Pourquoi a-t-on construit des canaux pour le transport de marchandises, et pas des routes ? La réponse est simple : une péniche, même de petit gabarit, transportait cent fois le contenu d’une charrette, et il suffisait d’un seul animal pour la haler. L’infrastructure nécessaire au carroyage des marchandises et aux diligences était très lourde et coûteuse : nombreux chevaux, relais de poste, maréchaux-ferrands, entretien des routes ,etc. Voilà pourquoi l’essentiel des marchandises, dans les siècles passés, empruntait fleuves et canaux. Deux mariniers et un cheval suffisaient pour mener 100 tonnes de fret à l’autre bout du pays. Le propre d’un chemin de halage, c’est qu’on y halait les péniches, à épaule d’hommes d’abord en passant en écharpe une sorte de harnais, mais le plus souvent à l’aide de chevaux, ânes ou mulets. Les péniches automotrices sont apparues après la première guerre mondiale, entraînant leur disparition sur le halage entre les deux guerres.

Comment est né ce Canal de Nantes à Brest ?
L’idée d’ouvrir une voie de navigation intérieure en Bretagne remonte au XVIe siècle, lors de la canalisation de la Vilaine, décidée par les États de Bretagne, permettant la première liaison fluviale de la capitale bretonne à Redon et au « golfe de Gascogne » par la Vilaine maritime. L’intérêt économique d’un canal de Nantes à Brest est de désenclaver le Centre-Bretagne permettant à tous les points de ce territoire d’être à moins de 15 kilomètres d’une voie d’eau (mer et ses rias, rivières ou canal). Mais faute de financement, ce projet est avorté. Il est relancé au début du XVIII puis au XIXe siècle, comme une parade au blocus maritime anglais sur les côtes de France. Il permettait de rallier tous les arsenaux militaires par une voie d’eau autorisant leur approvisionnement en toutes circonstances.
Les principales dates
• 1627 : Les États de Bretagne proposent un plan de canalisation de la Bretagne.
• 1804 : Études techniques de l’ingénieur Bouessel. Napoléon s’intéresse au projet.
• 1811 : La première pierre de la première écluse est inaugurée à Port-Launay.
• 1814 : Napoléon est exilé, les travaux cessent.
• 1822 : Reprise des travaux.
• 1842 : Le canal est ouvert au trafic sur toute sa longueur.
• 1890-1914 : La plus belle époque du canal.
• 1914 : Réquisition des péniches.
• Après 1914 : Concurrence avec le chemin de fer et la route. Déclin du trafic.
• 1928 : Mise en eau du barrage de Guerlédan. Le canal est coupé en deux parties.
• 1940 : Nouvelle réquisition des péniches.
• Après 1945 : Le canal tombe peu à peu en désuétude.
• 1977 : La dernière péniche, le Mistral, décharge son ultime cargaison de sable à Saint-Congard.
• Depuis 1964 : Le canal renaît peu à peu grâce au tourisme fluvial.
Une construction spectaculaire
Vous l’avez compris, un canal est une voie d’eau destinée à relier deux points, et à desservir par la même occasion les villes du pays traversé. Mais il y a deux siècles, les outils n’étant pas ce qu’ils sont aujourd’hui, il a fallu aux ingénieurs calculer le nivellement de chaque vallée traversée pour évaluer en conséquence le nombre d’écluses nécessaires. On n’est donc pas arrivé à 239 par hasard !
Un canal étant destiné à la circulation des péniches, il est important que l’eau soit plate. Celui de Nantes à Brest utilise surtout le cours de rivières existantes : de l’Erdre à l’Aulne, seulement 20 % de sa longueur (soit environ 73 km) est artificiel. Huit cours d’eau sont canalisés pour l’alimenter, ou aménagés pour les rendre navigables. C’est seulement lorsqu’il franchit une crête que les constructeurs vont creuser une courte section artificielle. Dans les deux cas, cours de rivière ou cours artificiel, il faut travailler la pente naturelle des terrains pour en faire une série de surfaces plates, un peu comme un escalier.
 L’écluse est une construction qui va aider la péniche à franchir l’obstacle du barrage. C’est un sas, fermé côté amont et côté aval par de solides portes de métal et de chêne, assez résistantes pour résister à la pression des centaines de tonnes d’eau. La longueur d’une écluse en granit sur ce canal est de 25.70 mètres et sa largeur de 4.70 mètres. À chaque écluse est associée une maison d’éclusier. Cette règle n’est pas générale, car dans les « échelles d’écluses », aux endroits des biefs de partage, là où les écluses sont voisines les unes des autres, un éclusier avait en charge plusieurs ouvrages.
L’écluse est une construction qui va aider la péniche à franchir l’obstacle du barrage. C’est un sas, fermé côté amont et côté aval par de solides portes de métal et de chêne, assez résistantes pour résister à la pression des centaines de tonnes d’eau. La longueur d’une écluse en granit sur ce canal est de 25.70 mètres et sa largeur de 4.70 mètres. À chaque écluse est associée une maison d’éclusier. Cette règle n’est pas générale, car dans les « échelles d’écluses », aux endroits des biefs de partage, là où les écluses sont voisines les unes des autres, un éclusier avait en charge plusieurs ouvrages.
Retour de la navigation
Depuis 1990, la gestion des voies navigables bretonnes a progressivement été déléguée conseil régional de Bretagne et au conseil départemental de la Loire-Atlantique qui en sont propriétaires. La navigation s’interrompant habituellement de fin octobre à fin mars, les agents profitent, par exemple, de cette période hivernale pour réaliser des travaux d’entretien et de restauration pour que le canal reste toujours vivant.
Dès la fin du XXIe siècle, le canal a attiré plaisanciers, pêcheurs, promeneurs et régatiers ! Depuis 1964, on assiste ainsi à une lente renaissance du canal au profit de la plaisance, même s’il n’est plus navigable dans sa continuité depuis 1930 et la mise en eau du barrage de Guerlédan. L’association Escales Fluviales de Bretagne œuvre pour la mise en valeur de ce patrimoine fantastique que représente le canal de Nantes à Brest.

Randonner sur le canal avec le guide Miam Miam Dodo
L’histoire d’amour entre le Miam Miam Dodo et le Canal de Nantes de à Brest a commencé il y a 30 ans : lorsque Jacques Clouteau et Ferdinand, son petit âne de bât, on assouvit un vieux rêve, celui de parcourir cet ancestral chemin de halage, creusé 180 ans plus tôt. Ils découvrirent un canal bien vivant, entouré de vieux arbres centenaires qui veillaient sur sa tranquillité, partageant leur solitude avec les rares pêcheurs ! Il existait donc un vrai chemin long de 364 km, à l’abri des voitures, baigné de silence et d’eau… et si peu de randonneurs le savaient.
Se rendant compte qu’aucun ouvrage décrivant le canal en tant qu’itinéraire de randonnée n’existait, ce guide Miam Miam Dodo naissait, depuis remis à jour régulièrement. La dernière parution remonte au printemps 2024. « À votre tour, vous marcherez ou pédalerez sur les pas de milliers de bagnards, de tâcherons, de charretiers et d’artisans qui ont creusé cette vallée d’eau au coeur de la Bretagne. Vous resterez époustouflé devant les prouesses techniques imaginées par les ingénieurs pour que fonctionne cette oeuvre titanesque. Vous comprendrez, pas après pas, quelle était la vie des bateliers qui ont foulé les berges du canal, tenant par la bride leur courageux compagnon à quatre pattes halant la lourde péniche… Le canal est notre mémoire vivante, le souvenir d’une époque toute proche où rien n’était facile, mais où tout se faisait quand même, au rythme des pas et des chevaux », rappelle Jacques Clouteau, fondateur du Miam Miam Dodo.
Dans ce guide Miam Miam Dodo du Canal de Nantes à Brest :
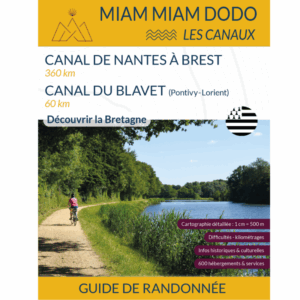
– dans le guide Miam Miam Dodo « Les Canaux » en cliquant ici.
– Canaux de Bretagne en cliquant ici.
Itinéraire bis : le canal du Blavet
Construite en même temps que le canal de Nantes à Brest, la bretelle qui relie Pontivy à Lorient en était une émanation nécessaire. Lorient, à la fois port de commerce et port militaire, se devait d’être ravitaillé « par voie de terre » même sous le feu des canons ennemis. On a vu que cette raison militaire est très vite tombée en désuétude lorsque la France et l’Angleterre ont fait la paix après les guerres napoléoniennes. Ne restait plus alors que la raison économique. Le Blavet, large rivière, à la pente faible, permettait de joindre facilement Pontivy, ville nouvelle au cœur de la Bretagne, à Lorient. Descendre les 28 écluses et les 60 kilomètres de Pontivy à Lorient demandait seulement un couple de jours à une péniche lourdement chargée qui effectuait ainsi à moindre coût le travail de centaines d’attelages traditionnels.
Le Blavet, que vous allez découvrir au printemps sous un aspect bucolique, est quelquefois une rivière à la tête bien folle, lorsque les pluies hivernales dévalent de toutes les crêtes armoricaines. Le chemin de halage s’arrête à Hennebont, ainsi que notre description. Il n’existe pas encore de sentier permettant de continuer pedibus jambis jusqu’à Lorient le long de l’estuaire du Blavet. Aussi devrez-vous marcher sur la route, ou prendre bus ou taxi pour rejoindre Lanester et Lorient, qui sont toutefois très proches de Hennebont.